[ #HistoiresExpatriées ] Les rapports humains…
(avec pour marraine Kenza, expatriée au Canada)
Thème proposé :
LES RELATIONS SOCIALES
Mais la difficulté pour moi provient aussi du décalage permanent que j’ai pu ressentir lors de ma parenthèse expatriée, la rencontre (improbable) entre deux mondes si différents que le concept même de “vie commune” comme fondement de toute relation sociale était une hérésie.
Les relations avec “sa communauté” expatriée…
Oui, certes, peut-être… quoique, en fait, non, pas forcément !
Quand on vit loin de son pays d’origine, et a fortiori dans un endroit où le dépaysement est abyssal, il arrive un moment où, immanquablement, on cherche à nouer des relations avec des personnes dans la même situation, en l’occurrence d’autres expat’. Tous les critères d’âge, d’affinités et autres points communs passent clairement au second plan (au départ de l’action) ! C’est encore plus vrai lorsque le coin où on atterrit n’en est pas très fréquenté…
Ce fut notre cas dès notre arrivée au Sénégal en 1994, propulsés à Kaolack et ses 150 000 habitants. Assez confiants à cette époque (en réalité, encore jeunes et un peu naïfs…), on pensait qu’avec une ville de cette taille, la probabilité était plutôt bonne de trouver une communauté d’expat’ (et assimilés) assez conséquente. Dans les faits, à peine une trentaine d’occidentaux était recensée, dont seulement une dizaine de francophones (largement plus âgés que nous deux). L’embarras du choix quoi !
N’ayant trouvé aucune réelle opportunité à l’Alliance Franco-Sénégalaise de Kaolack, c’est ainsi qu’on s’est retrouvés à fréquenter uniquement Le Cercle…
Ne pas se fier à ce nom plein de mystère ésotérique : il ne s’agissait ni d’une secte, ni d’une société secrète ! Ce n’était qu’une sorte d’Association des coopérants français habitant Kaolack. J’en ai déjà parlé dans le premier numéro de mes #HistoiresExpatriées :
《 L’ambiance était plutôt conviviale, ça nous permettait de nous retrouver un peu entre nous, et ça faisait du bien parfois !
Le Cercle occupait un local simple et sans prétention, avec un coin bar dans une grande cour ombragée, avec un terrain pour le tennis ou le volley, un coin pour jouer à la pétanque, et aussi de quoi jouer au ping-pong. Il y avait des jeux de cartes et de société, une petite bibliothèque avec quelques livres empruntables et des magazines, et puis une télévision.
Deux soirs par semaine, des repas à menu fixe étaient organisés : le lundi c’était “brochettes”, et le jeudi c’était “spaghetti bolognaise”. Mais le Cercle était ouvert chaque jour, on pouvait passer boire un verre quand on voulait. Chacun avait son carnet de compte pour y noter toutes ses consommations, et chacun réglait sa note à la fin de chaque mois. 》
Bref, c’était radio potins en direct du tribunal, avec jugement expéditif par contumace ? ! Rien de bien différent de la France finalement, sauf que là, on ne choisissait pas ses fréquentations.
Je n’osais même pas imaginer ce qu’on pouvait raconter sur nous, pauvres petits CSN (=Coopérant du Service National) sans vrai statut d’expat’ (ni aucun des avantages qui va avec) ! Et que penser alors de ma position, la “femme de CSN” ayant suivi son Homme juste par amour ? Je devais probablement être vue comme une extra-terrestre un peu maso…
La grande majorité des expat’ étaient des hommes justement, en contrat de mission à durée déterminée en Afrique. Rares étaient les épouses ayant réussi à vivre là-bas plus de quelques jours (quelques semaines pour les plus résistantes). Malgré des conditions de vie sur place plus confortables que celles que j’avais pu connaître, la plupart avaient repris leurs cliques et leurs claques et étaient rentrées en France fissa… Elles préféraient attendre leur mari dans leur zone de confort.
Lors des rencontres au Cercle au début, ce qui était cocasse c’était d’assister aux joutes verbales qui s’engageaient dans le clan des “déjà là avant” lorsque ceux-ci prodiguaient leurs conseils avisés (qu’il faut suivre à la lettre plutôt que ceux des autres) et autres bons tuyaux aux “petits nouveaux fraîchement débarqués”. C’était à celui qui avait raison, la parole divine, la science infuse, l’expertise de tout (et n’importe quoi) et surtout le dernier mot. On sentait bien que tout le monde n’était pas d’accord sur tout (et c’est bien normal), que les esprits s’échauffaient parfois, mais cette nécessité de lien social empêchait que les débats ne dégénèrent (trop) au final.
Pendant les mois où on habitait à Kaolack, en dehors du Cercle, les relations sociales entre expat’ étaient encore plus limitées : il faut moins de doigts d’une seule main pour les compter… Parmi les rares français qu’on fréquentait régulièrement, il y avait notamment le patron d’alors de Philéas, sur qui on a toujours pu compter. Il fait d’ailleurs partie des deux seules personnes avec qui on est restés en contact (jusqu’à aujourd’hui encore) après avoir quitté le Sénégal en 1995.
Plus tard, après avoir déménagé à Thiès, c’était un peu la même chose, avec toutefois le Cercle en moins puisqu’il n’existait pas d’équivalent dans cette ville-là. Pourtant, il y avait plus d’expat’ qu’à Kaolack. Finalement, sans lieu commun de rendez-vous où pouvait se retrouver la communauté expatriée, ça enlevait pas mal d’opportunités de convivialité de groupe.
Tout ça me semblait un peu factice, mais on ne pouvait blâmer personne. Il était toujours difficile de s’impliquer vraiment dans de nouvelles relations sincères (et désintéressées) quand on savait pertinemment, par avance, qu’elles seraient forcément à durée déterminée.
Et sinon, en dehors des autres expatriés ? Et bien avec les autochtones, les relations sociales étaient réduites à la portion congrue.
Divergences culturelles et incompréhensions…
Il ne faut pas y voir malice, c’est juste comme ça. Contrairement à notre culture occidentale moderne où l’individualisme domine, dans la culture sénégalaise, la vie est un sport collectif où le partage prime. Au Sénégal,《 Niofar ! 》(= on est ensemble !), c’est une injonction !
Les valeurs culturelles de générosité ont également une dimension religieuse dans les populations de confession musulmane. En effet, accueillir et être généreux est un devoir préconisé par l’Islam, récompensé par une bénédiction Divine promettant l’accès au Paradis. De là à penser que la carotte au bout du bâton, c’est plus motivant…
Mais les dés sont un tantinet pipés. Aux yeux des africains, le toubab (=blanc occidental) est forcément un nanti (ce qui n’est pas complètement faux dans l’absolu, mais comme tout est relatif…), donc le candidat idéal à l’échange à la sauce sénégalaise…
À force d’expériences pas toujours super agréables là-bas, quand quelqu’un nous abordait sans raison apparente, j’avais fini par avoir l’impression que ce n’était que par intérêt. Je caricature délibérément le trait, mais j’avais l’impression de ce genre de sous-entendus :
《 Toi, t’es un blanc-bec privilégié qui ne manque de rien. En plus, tes ancêtres ont colonisé les miens. Donc je vais t’adresser la parole et être super sympa avec toi, comme ça, en échange, pour réparer le préjudice, tu devras m’aider, de préférence financièrement parlant évidemment. 》
Alors fatalement, le toubab débarquant au Sénégal avec sa culture (plus ou moins prononcée) du “chacun pour soi”, risque de frôler l’overdose de sollicitations incessantes sous lesquelles il va inévitablement crouler. Moins de cinq minutes après avoir engagé la conversation, il va devenir l’ami de toujours, et qui dit “ami” au Sénégal, dit devoir d’entraide et de solidarité. Et ce nouvel “ami” de toujours a forcément une tripotée de membres de sa famille malades, dans le besoin, avec des problèmes (même si, au Sénégal, c’est bien connu, amoul solo [= pas de problèmes]…), etc. Si le toubab est un peu trop naïf empathique et répond favorablement, alors il est foutu et ne se sortira plus de l’engrenage sans fin ! En revanche, si le toubab n’est pas complètement dupe, ou qu’il réalise qu’il se fait avoir, il va finir par s’agacer de se sentir comme un porte-monnaie ambulant, un pigeon se faisant plumer à longueur de journée.
Au lieu d’être source d’enrichissement, ce décalage culturel en devient souvent source d’incompréhensions.
En vivant dans le pays, être confrontés à trop de “profiteurs du système”, ceux qui galvaudent leur “générosité innée” pour tenter de soutirer le maximum de choses, nous a rendus méfiants, voire probablement un peu paranos. Il faut dire aussi qu’on a accumulé les mauvaises expériences, la faute à pas de chance, mais le mal était fait… Du coup, on a fait ce qu’il ne faut jamais faire : généraliser. On en est venus (à tort) à mettre tous les sénégalais dans le même panier et à s’en tenir éloignés le plus possible pour se protéger des relations sociales nous semblant ne pouvoir être qu’intéressées.
Ce que j’avais trouvé un peu paradoxal là-bas c’était de constater que les relations sociales entre sénégalais n’étaient pas si évidentes et naturelles que ça finalement.
Pourtant, comme j’en ai déjà parlé dans un précédent article, les sénégalais excellent en matière de sociabilité et de solidarité, que ce soit dans leur art des salutations (sans fin) bannissant l’indifférence sociale, ou dans leur pratique du marchandage (tragicomique) se révélant être un exercice d’échange social très subtil, ou bien encore dans la réalisation de tontines, parfait exemple africain de relations solidaire.
La tontine est un système collaboratif d’épargne auquel participe un groupe de femmes (la plupart du temps) d’un même village ou quartier. Le principe est simple : durant une période donnée, à échéances régulières, chaque participante verse dans un “pot commun” une petite somme fixée par avance. Au terme de chaque tontine, l’argent récolté dans la cagnotte est attribué à l’une des femmes. Et une nouvelle tontine est lancée. Ainsi, le système contribue à mieux répartir et distribuer des ressources à tour de rôle aux familles.
Le problème est que, parfois, ces sacrosaintes relations sociales pouvaient être plus subies qu’autre chose. C’était particulièrement le cas avec la sphère familiale, une autre dimension qui accentue un peu plus l’injonction de la culture du partage !
Le centre de la vie sociale sénégalaise c’est la famille, tel le noyau d’un atome autour duquel gravitent une multitude d’électrons. La notion de famille s’entend au sens très large : des parentés directes les plus proches jusqu’aux parentés indirectes les plus lointaines, le tout démultiplié par le nombre d’épouse le cas échéant ! Établir un arbre généalogique complet relèverait de la mission quasi impossible.
La famille est une assurance vie au Sénégal. Mais d’après ce que j’ai pu constater, ce n’est pourtant pas la panacée. D’un côté, elle est une grande force, grâce à la réelle solidarité indéfectible y régnant. D’un autre côté, elle est une vraie faiblesse en raison du poids considérable qu’elle peut avoir sur les individus la constituant et ne pouvant s’y soustraire, “emprisonnés” dans des obligations culturelles de devoir moral qui les dépassent et les contraignent.
D’ailleurs, il n’y a qu’à regarder les publicités à la télévision sénégalaise pour prendre la mesure du décalage entre la vie idéalisée et la vie réelle… Les pubs vantent rarement (pour ne pas dire jamais) les mérites de la famille traditionnelle super élargie telle qu’elle existe pour de vrai. Celle avec, en plus des ascendants et collatéraux (plus ou moins directs) du mari, ses multiples femmes (la polygamie est d’usage au Sénégal), plus fertiles les unes que les autres (la compétition et les jalousies font rage entre les co-épouses… Avoir plus d’enfants qu’une autre revient un peu à dire être la favorite ayant eu le plus les faveurs du mari commun…), et la nombreuse progéniture engendrée, tout ce beau monde vivant en communauté dans un même lieu partagé (appelée concession familiale). La pub télévisée ne montre que le fantasme du modèle “à l’occidentale”, la famille composée d’un couple monogame avec maximum trois enfants (l’idéal étant l’enfant unique), habitant un magnifique appartement meublé immaculé dans un immeuble construit (et achevé) en “dur” dans un beau quartier tout propre. Bref, le truc plutôt utopique au Sénégal !
Pour donner une idée, à l’époque où je vivais au Sénégal (au milieu des années 90), le SMIC local (théorique… ça ne fonctionne pas du tout comme en France là-bas) représentait à peu près 55 € par mois (pour 40h/semaine) pendant qu’il s’élevait à environ 940 € par mois (pour 40h/semaine) en France. La famille restée au pays ne comprenait pas qu’avec un tel salaire, leurs exilés ne transféraient pas plus d’argent. Ils avaient beau se justifier en expliquant le concept relatif de pouvoir d’achat et en accusant le coût de la vie français exorbitant par rapport au Sénégal, seul le montant du salaire paraissant astronomique était retenu.
Ce genre de situation était à l’origine d’incompréhensions, de tensions, de reproches et de conflits inextricables d’une part, et d’un profond malaise par peur d’être rejetés/exclus/bannis de la famille (sanction ultime, humiliation suprême) d’autre part.
Ceux qui parvenaient à partir étudier, puis à trouver un emploi stable rémunérateur, finissaient automatiquement le bec dans l’eau, pieds et poings liés, car sans autre choix que de devenir la vache à lait source de financement intarissable de toute la communauté. Ce qui dispensait et/ou dissuadait finalement les autres membres de la grande famille de faire l’effort de tenter leur chance à leur tour. C’était un véritable cercle vicieux…
Il était Peul, ethnie nomade du Sénégal, et vivait paisiblement, en itinérance avec toute sa communauté et leur bétail, de manière traditionnelle (rude et plus que spartiate), sans aucun besoin d’argent puisque autonome et autosuffisant. D’ailleurs, il m’avait dit qu’il ne savait pas vraiment ce qu’était l’argent avant ; chez eux, en cas de besoin, on faisait du troc. Il se sentait très heureux comme ça, ne manquant de rien pour subvenir à ses besoins basiques primaires (pendant que nous, en Occident, ne sommes jamais satisfaits de tout ce qu’on a…). Son discours était d’une logique implacable : à quoi peut bien servir l’argent dans un environnement où il n’y a rien besoin d’acheter ?
Il était l’aîné de sa fratrie. Un jour, un de ses frères était tombé gravement malade, au point que la “médecine” traditionnelle ancestrale n’y pouvait rien. N’ayant pas d’argent, personne n’était en mesure de payer ni consultation médicale ni médicaments. Comme il était (culturellement) inconcevable pour son père de vendre un des zébus du troupeau (véritable trésor de guerre sur pattes, plus important que la santé d’un enfant manifestement…) pour pouvoir payer les soins, il avait alors été désigné pour quitter la communauté et partir à Dakar pour trouver du travail et gagner de l’argent pour pouvoir soigner son petit frère.
Il avait réussi à remplir sa mission, découvrant par la même occasion la vie urbaine, un tout autre mode de vie dont il ne soupçonnait même pas l’existence jusque-là. Mais le plus terrible c’est qu’il n’avait pas eu le droit de retourner vivre en brousse parmi les siens. Il avait été contraint de rester à la Capitale pour continuer à trouver toujours plus d’argent, pour subvenir à ses propres besoins d’abord, mais surtout pour financer tous ceux de sa communauté devenus un peu trop addict au fric… Perversion d’un système conjuguée à la dictature familiale…
Il vivait très mal cette situation, comme une forme d’esclavagisme des temps modernes dont il ne pouvait pas se soustraire. Mais de son propre aveu, il n’avait pas le choix, question d’honneur. Il était ainsi devenu très malheureux de devoir vivre avec le stress de la nécessité de trouver de l’argent à tout prix dans “l’enfer” de la Capitale.
Son histoire m’avait démontré que l’argent ne fait pas forcément le bonheur… (même s’il peut beaucoup y contribuer !)
Rencontres improbables avec “l’autre”…
Si entretenir de vraies relations sociales avec les locaux était un peu voué à l’échec lors de ma parenthèse expatriée, il était en revanche impossible de passer à côté des rapports humains. Et ça, c’est grâce à l’incontournable teranga sénégalaise !
La teranga, l’art de l’hospitalité, de l’accueil de “l’Autre”, est un état d’esprit axé sur la générosité et le sens du partage. C’est la marque de fabrique du Sénégal, ce qui cueille d’abord, touche ensuite, envoûte enfin tout étranger allant à la rencontre des sénégalais (les authentiques, pas ceux de la catégorie des imposteurs, les faux chaleureux pervertis par le tourisme et dont le seul but est de se faire de l’argent) au-delà des lieux purement touristiques.
La première manifestation de cette légendaire teranga, ce sont les salutations. Tout commence par là, rien n’est possible sans ça. J’en ai déjà parlé en détail dans un article précédent.
Les bonjours pleuvent de partout, tout le temps et durent longtemps. C’est tout un rituel, agrémenté d’interminables serrages de mains, pouvant parfois être drôle à observer et à expérimenter tant les sénégalais ont un sens de l’humour affirmé. C’est aussi et surtout une excellente entrée en matière pour engager la conversation (et, par la même occasion, passer une partie de la journée “main dans la main” avec les personnes croisées sur son chemin).
Une fois ce premier contact établi, il est courant de se voir rapidement invité à partager un moment de convivialité : les trois thés, un repas voire carrément une nuitée. Les sénégalais ouvrent naturellement les bras pour accueillir le visiteur étranger rencontré, et ils se plieront en quatre pour le mettre à l’aise.
Que ce soit lorsque nous vivions au Sénégal, ou plus tard lors de chacun de nos voyages là-bas, nous avons goûté à la teranga. À de multiples reprises nous avons été conviés “chez l’habitant” à l’occasion d’une fête de quartier typique, d’un repas familial ou même une fois lors d’un mariage traditionnel (où le marié n’était même pas présent car à l’étranger ! C’était insolite !).
Pour illustrer tout ça, voici quatre tranches de vie que j’ai choisies de raconter.
➤ À peine quelques jours après avoir débarqué au Sénégal en 1994, nous avions été invités à manger chez une personne de l’entourage professionnel de Philéas. Ce fut pour moi la première rencontre authentique d’un mode de vie aux antipodes du mien.
Le fait d’être conviée aussi chaleureusement, chez une famille que je ne connaissais pas du tout, m’avait beaucoup surprise et pas mal gênée aussi. Question d’éducation (et de timidité). Jamais il ne me serait venu spontanément à l’idée d’inviter des inconnus à venir manger chez moi parmi mes proches.
Ce jour-là, on est arrivés peu avant midi dans la concession familiale de ladite personne. Enfin, pour être plus précise, dans la concession de sa belle-famille car quand il a épousé sa femme, il a aussi “épousé” toute sa belle-famille avant de partir vivre avec toute sa nouvelle communauté d’adoption.
Concrètement, cette concession familiale est un bout de terrain délimité soit par des empilements aléatoires de briques, soit par des haies de branchages tressés. Plusieurs baraques faites de bric et de broc y sont dispersées en guise de lieux de vie.
Là, toute la basse-cour cohabite joyeusement. Dans un coin, des truies aux mamelles XXL, avec un porcelet pendu à chaque tétine, sont vautrées dans une flaque d’eau croupissante et malodorante. Au milieu, les poules et les coqs se pourchassent frénétiquement dans tous les sens. Des chèvres cherchent désespérément des brins d’herbes à brouter. Quelques chiens miteux hagards traversent la cour de terre battue pour s’effondrer à l’ombre de l’immense arbre qui trône au centre. Un âne fait le pied de grue dans un coin, comme s’il était puni au piquet, quand il ne brait pas soudainement en grinçant comme une pompe grippée.
Tous les enfants courent et jouent en hurlant au milieu de tout ça. Les femmes et les filles sont toutes occupées aux gamelles sur le feu, ou à la vaisselle, ou à la lessive, ou à toutes les autres tâches ménagères dont elles sont responsables. Le partage des tâches avec les hommes est un concept impensable au Sénégal, d’où la tolérance (et même parfois l’adhésion) pour la polygamie par bon nombre de femmes qui disent, qu’ainsi, elles peuvent se répartir le travail de la maison et des enfants. Si l’une d’elles est malade, au point de ne pouvoir assumer quand même ses besognes quotidiennes, les autres peuvent (doivent) prendre le relais.
Notre hôte vient nous accueillir tout sourire, la fierté se décelant dans ses yeux, et nous accompagne dans une des bicoques. Là, c’est le moment du cérémonial des salutations. Harcelés par les nuages de mouches, et transpirant à grosses gouttes avec la chaleur étouffante régnant là-dedans, on salue en serrant la main à tout le monde, avant d’aller s’assoir par terre sur une natte. On nous offre de quoi boire avant qu’une table basse ne soit approchée : c’est l’heure de manger.
Seuls notre hôte, son épouse et leur fils en bas âge, ainsi qu’un collègue (sénégalais) de bureau de Philéas, ont “le droit” de rester manger avec nous. Tous les autres se tiennent en retrait plus loin et nous regardent fixement. C’est extrêmement gênant (d’autant plus gênant quand j’ai compris pourquoi à la fin du repas…).
Chaque plat (tous délicieux) arrive dans une grande gamelle qui est commune : pas d’assiette individuelle. Chacun délimite une zone dans le plat devant soi, et pioche sa part dedans. Pour nous mettre à l’aise (il sait que nous n’avons pas trop l’habitude (encore) de manger avec les doigts), notre hôte nous donne une fourchette à chacun (ce qu’on trouve bizarre car d’habitude ce sont plutôt des cuillères). Son épouse n’en prend pas et mange traditionnellement, avec la main droite (la gauche est considérée comme impure, car notamment réservée à d’autres fonctions “sanitaires”…). Pour l’un des plats, elle déchire des morceaux de poulet, les effiloche, les pétrit soigneusement dans sa main, en mange, en mâche pour donner la béquée à son fils assis sur elle, se lèche généreusement les doigts avant de recommencer l’opération… pour nous cette fois ! Elle pose les morceaux ainsi préparés (et copieusement pourléchés !) devant nous. Là, j’ai vraiment eu un mal fou à dépasser mon réflexe de dégoût, manger ces morceaux me paraissant insurmontable. Comme je ne voulais surtout vexer personne, j’y suis quand même arrivée “au mental” ! Bon, c’est sans doute une pure coïncidence (ou pas…), mais 24 heures après, une méchante gastro-entérite carabinée (pas juste une tourista) m’a clouée au lit plusieurs jours avec une fièvre de cheval et la double vidange massive par en haut et par en bas…
Pendant ce vrai moment de rencontre et de partage intense (tellement intense que mon système immunitaire n’a pas supporté le choc !), on nous a traités comme des rois. Pourtant il n’y avait pas de raison, et ça m’a mise mal à l’aise. Surtout lorsque j’ai compris pourquoi tous les autres nous observaient pendant qu’on mangeait… Quand on a été repus, ils se sont précipités sur les gamelles et ont emporté les restes dans la pièce d’à côté pour manger à leur tour… C’est ainsi que ça fonctionne avec la teranga : l’invité passe toujours avant.
 ➤ Lors de la cérémonie des trois thés, appelée ataya, dès que l’occasion se présentait, je ne refusais jamais une telle invitation. Même si ça durait des heures (si on commence, il est très mal vu de ne pas aller jusqu’à la fin). Même s’il fallait partager les mêmes verres (pas très propres et tout collant) avec tous les autres participants (idéal pour diversifier et renforcer toujours plus son système immunitaire !). Même si je savais que j’allais me brûler la langue au troisième degré (mais au moins, l’eau était bouillie…). Même si je ne faisais pas suffisamment de bruit en le sirotant (un bon gros “sssllluuurp” bien humide fait partie du rituel !). Même si je manquais m’étouffer avec les feuilles de thé que je ne savais pas bien filtrer comme il faut avec la mousse pourtant faite pour ça (c’est toute une technique !). Même si tout ce feuillage me restait coincé partout entre les dents (effet sourire moucheté garanti !). Même si le breuvage me tordait à peu près systématiquement les boyaux (idéal en cas de tuyauterie interne bouchée)… Et même si trop de théine ingurgitée trop tard dans la journée me promettait une nuit encore plus agitée qu’à l’accoutumée.
➤ Lors de la cérémonie des trois thés, appelée ataya, dès que l’occasion se présentait, je ne refusais jamais une telle invitation. Même si ça durait des heures (si on commence, il est très mal vu de ne pas aller jusqu’à la fin). Même s’il fallait partager les mêmes verres (pas très propres et tout collant) avec tous les autres participants (idéal pour diversifier et renforcer toujours plus son système immunitaire !). Même si je savais que j’allais me brûler la langue au troisième degré (mais au moins, l’eau était bouillie…). Même si je ne faisais pas suffisamment de bruit en le sirotant (un bon gros “sssllluuurp” bien humide fait partie du rituel !). Même si je manquais m’étouffer avec les feuilles de thé que je ne savais pas bien filtrer comme il faut avec la mousse pourtant faite pour ça (c’est toute une technique !). Même si tout ce feuillage me restait coincé partout entre les dents (effet sourire moucheté garanti !). Même si le breuvage me tordait à peu près systématiquement les boyaux (idéal en cas de tuyauterie interne bouchée)… Et même si trop de théine ingurgitée trop tard dans la journée me promettait une nuit encore plus agitée qu’à l’accoutumée.
L’ataya, au début, je le boudais un peu, j’étais réticente juste à cause des conditions d’hygiène. Et puis mes freins se sont débloqués et depuis j’aime ça ! On a ramené tout le nécessaire et la recette pour pouvoir se le faire en France une fois rentrés au pays. C’est Philéas qui s’y colle, mais trop rarement car ça prend trop de temps…
➤ Un jour, j’ai pu accompagner Philéas lors d’un de ses déplacements professionnels en brousse. C’était en Casamance, tout au Sud du pays, dans un lointain petit village près de la frontière avec la Guinée-Bissau. Le coin était isolé au point que la plupart des habitants que nous avons croisés n’avaient jamais vu de “blancs” auparavant. D’ailleurs cette fois-là, j’avais eu la désagréable impression d’être un animal de foire génétiquement modifié, avec tous les gamins qui me sautaient dessus pour toucher ma peau blanche comme un cul et pour tirer sur ma longue tignasse rouquine bouclée (au Moyen-âge, ma crinière m’aurait envoyée sur le bûcher pour être brûlée en place publique ?). Mais bon, je m’égare…
Bref, la notion de temps étant très extensible au Sénégal, la grande réunion sous l’immense manguier (duquel tombaient d’énormes mangues manquant nous assommer) à laquelle on assistait (avec des villageois portant des bonnets de laine malgré la chaleur infernale), s’était éternisée. L’heure du repas de midi était largement dépassée, c’était plutôt l’heure du goûter. Avec la chaleur suffocante, la fatigue, la faim, la distance/temps de pistes et routes défoncées nécessaires au retour, on s’est vu défaillir… Mais c’était sans compter sur la légendaire teranga !
Le plus puissant, riche et très respecté homme de ce village, plus gros éleveur de bétails de la zone (et accessoirement plus gros usurier aussi), nous invite à venir manger dans sa concession familiale, située en “périphérie” du village, au détour de quelques termitières “cathédrale” (gigantesque édifice animal en terre, bien plus haut qu’un homme, de forme plus ou moins pyramidale) et de termitières “champignon” (le modèle tout petit, en forme de champignon de paris).
Là, on nous conduit jusqu’à une case traditionnelle où il nous a presque fallu nous mettre à quatre pattes pour pouvoir y rentrer tellement la “porte” était basse. Comme à l’accoutumée, on s’assoit sur une grande natte par terre. On se met à agiter les mains dans tous les sens pour chasser les nuages de mouches qui jouent avec nos nerfs en essayant de nous rentrer dans la bouche, les narines et les yeux. On nous apporte un petit seau d’eau avec un morceau de savon pour pouvoir se laver/rincer les mains en même temps… Le premier qui s’y colle a les mains (à peu près) propres, mais pour le dernier, il doit se laver avec l’eau sale de tous ceux qui l’ont précédé !
La grande gamelle commune arrive, avec des cuillères fournies pour les invités (youpi !!!). Personne de la concession familiale ne se joint à nous pour le repas, même s’il y a deux collègues sénégalais de Philéas avec nous. Pas même notre hôte, qui ne nous rejoint qu’à la fin du repas. Là-bas, c’est comme ça. On nous explique que c’est une marque de respect pour ne pas nous mettre mal à l’aise quand on mange.
On ne sait pas du tout ce qu’on va devoir ingurgiter, mais comme on est (trop) confiants, on se réjouit de pouvoir au moins manger du riz (base de l’alimentation la plupart du temps), histoire de faire taire notre faim jusqu’au soir. Sauf qu’il n’y a pas l’ombre d’un grain de riz au menu ! Dans la gamelle, il n’y a que des gros morceaux de viandes (forcément, chez un éleveur de zébus, on mange du zébu) baignant dans un jus d’huile. En guise d’accompagnement, il y a des sortes de petits pains typiques à base d’un mélange de farines de mil et de blé. C’est très compact, il faut avoir de sacrées mâchoires pour le mastiquer suffisamment et éviter de s’étouffer en l’avalant. Pour faciliter l’opération (mais pas la digestion…), il faut tremper les morceaux de pain dans le jus d’huile.
En même temps qu’ils brassent l’air avec une espèce d’éventail en osier pour virer les mouches qui plongent goulûment dans notre repas, les deux collègues sénégalais nous découpent spontanément des petits morceaux de viande avec les doigts et nous les jettent devant notre “coin de gamelle”. Là encore, on ne demande rien, mais pour eux c’est naturel. Malgré ça, couper cette viande, savoureuse mais assez raide, avec une cuillère n’est franchement pas facile, alors je finis carrément le repas les mains dans l’huile pour manger avec les doigts moi aussi ! Ce jour-là, j’ai définitivement passé un cap et repoussé une de mes nombreuses limites (moi qui, jusqu’alors, chipotais pour un rien dès que j’étais devant mon assiette).
Le repas terminé, on nous ramène un nouveau seau d’eau propre pour (tenter de) se dégraisser les mains. Même cirque qu’au départ de l’action, mais avec un état de l’eau après usage encore plus dégueulasse.
La gamelle est récupérée. On aperçoit une ribambelle de gamins qui s’y jettent dessus pour manger. Je suis tellement gênée. Mais nos hôtes sont honorés…
La doyenne du village nous avait apporté de quoi manger aussi : une grande gamelle remplie de fonio accompagné d’une sauce à base d’arachide. Là encore, on n’avait rien demandé (de toute façon, elle ne parle ni ne comprend le français). C’était juste normal et naturel pour elle.
Le lendemain, au moment de les quitter, ils nous avaient offert un sac de 5 kg de fonio et un poulet vivant !
Sacrée claque que de rencontrer des personnes qui n’ont pratiquement rien mais qui, malgré tout, vous donnent tout ce qu’elles peuvent… Sacrée leçon de vie pour nous autres français hyper privilégiés mais jamais contents, gâtés pourris par la vie que nous ne savons pourtant pas apprécier à sa juste valeur, trop occupés à râler en permanence…

➤Au cours de ce même family trip, l’incroyable hospitalité sénégalaise nous a scotchés à deux autres reprises, au milieu de nulle part, en plein cœur du Parc National du Niokolo Koba.
On y était partis faire un safari-photo de deux jours avec bivouac dans le Parc au milieu des animaux.
Le second jour à la mi-journée, on s’était arrêtés dans un “campement”. On y a rencontré trois sénégalais travaillant là. On s’est installés pour pique-niquer avec leur autorisation. On avait déjà fini de manger quand eux se sont mis à préparer leur repas. Quand leur grande gamelle a été prête, ils l’ont posée sur un seau et se sont assis tout autour. Et ils nous ont invités à partager leur repas ! Sauf que nous, on était déjà bien rassasiés, alors on a poliment refusé en expliquant pourquoi. Mais j’ai senti que ça les vexait… Alors je me suis levée et je me suis jointe à eux pour manger quelques cuillères de riz de leur thieboudienne (= plat national sénégalais) tout en papotant avec eux.
J’ai seulement voulu faire honneur à la teranga (même si mon estomac, plein au-delà de l’entendement, me l’a bien fait regretter tout l’après-midi. J’avais presque les dents du fond qui baignaient…).

Le soir, on n’avait pas pu atteindre le lieu de bivouac prévu au départ. Alors notre guide avait décidé de nous emmener en lieu sûr (à cause des animaux sauvages dangereux peuplant la zone) avant la tombée de la nuit, dans un campement proche de notre position.
Là, il y avait deux militaires en poste. On n’était pas du tout prévus dans leur programme. Mais quand on leur a demandé l’autorisation de simplement planter nos tentes en sécurité pour camper la nuit, ils ont accepté sans aucun problème. L’un d’eux nous a même escortés avec son fusil jusqu’à la rivière pour que Philéas puisse aller faire un petit plouf rafraichissant. Nous avons ensuite passé la soirée avec eux, autour du feu, avant qu’une jolie genette, tranquillement allongée sur une branche d’arbre, ne vienne mettre l’ambiance à l’heure du coucher.
Cette soirée et nuit-là furent épiques !


Les relations sociales au Sénégal n’ont donc pas été réellement possibles pour nous pendant notre parenthèse expatriée.
Beaucoup trop de paramètres ont constitué des freins ou ont considérablement compliqué les choses, comme, par exemple, les barrières linguistiques et/ou culturelles.
Mais grâce au tempérament généreux et très ouvert des sénégalais, grâce à leur spontanéité à aller vers “l’Étranger”, la rencontre avec “l’Autre” a bel et bien eu lieu. Une situation similaire ne pourrait pas se passer ainsi en France où l’hospitalité n’est pas du tout innée.
Depuis l’époque de notre expatriation jusqu’à aujourd’hui, plus de vingt ans après, j’ai pu constater au fil des années dans l’évolution des choses là-bas, que les relations sociales dans la société sénégalaise sont en profonde mutation.
Deux phénomènes majeurs me semblent révolutionner la culture de l’échange propre au pays.
D’une part, une transition inéluctable s’opère entre la ruralité et l’urbanisation. Les modes de vie étant très différents, les valeurs traditionnelles farouchement préservées sont en train de voler en éclat.
D’autre part, ce phénomène est désormais combiné au fléau d’internet en général, et des réseaux sociaux en particulier, touchant aussi énormément le Sénégal. La nouvelle génération, ultra connectée, n’a que faire de la solidarité, l’hospitalité, la générosité. La jeunesse sénégalaise rejette de plus en plus tout ça en bloc, préférant se regarder le nombril. Elle veut s’émanciper du modèle traditionnel axé sur le “collectif” pour tendre vers le modèle occidental purement individualiste imposé par le rouleau compresseur de la mondialisation.
Malheureusement, j’ai bien peur que ce fléau n’ait signé l’arrêt de mort de la solidarité et des relations transgénérationnelles au Sénégal.
J’espère juste que l’incomparable teranga sénégalaise ne finira pas par purement et simplement disparaître un jour, ce serait tellement dommage…
édition n°4 : Ma nouvelle routine…
édition n°3 : Pourquoi es-tu partie ?
Toutes les autres participations abordant ce thème sont listées en fin d’article ici.

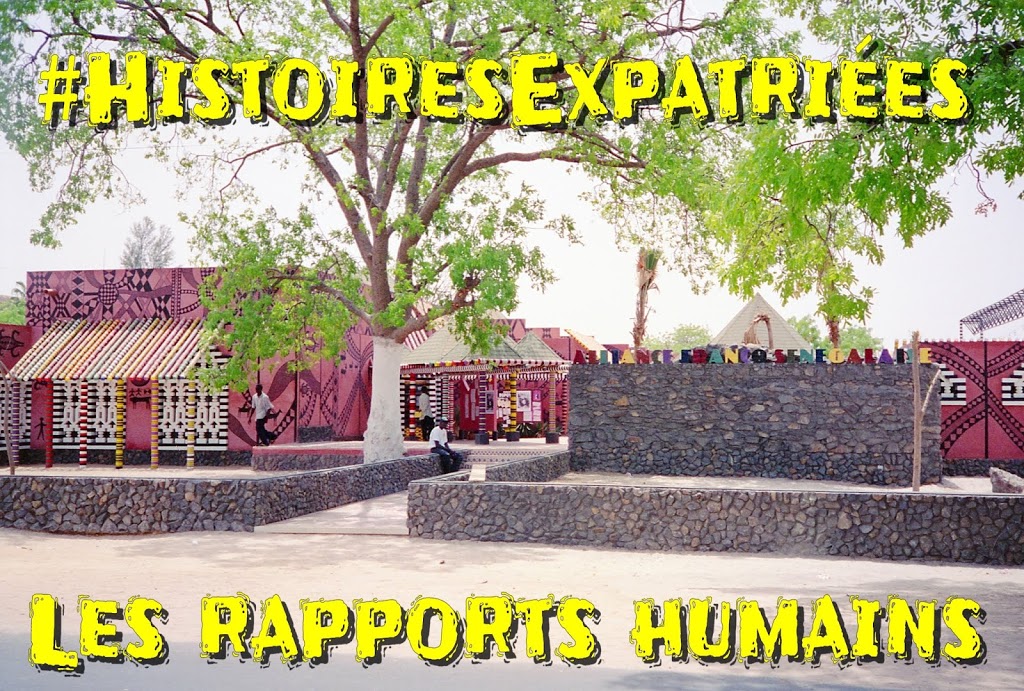










ahah
j'espère que tu ne vas pas finir par faire une indigestion !!!
Sur Facebook, à l'annonce de ce splendide reportage, j'avais dit que j'allais regarder cela avec gourmandise. Je n'ai pas été déçu, je me suis régalé !